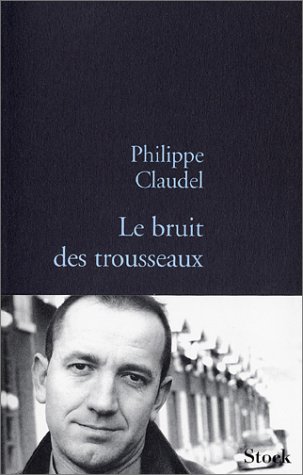Dans « le bruit des trousseaux » (Stock, 2002), le romancier et cinéaste Philippe Claudel raconte par une série de « flashs » son expérience d’enseignant dans une maison d’arrêt.
Le livre de Philippe Claudel me touche particulièrement car il fait écho à mon expérience de visiteur de prison. Il a souhaité dans ce court volume rassembler des choses vues et entendues alors qu’il était enseignant dans une maison d’arrêt. Il évoque l’ambiance de la prison, ses bruits, ses odeurs et ses non-couleurs, des moments vécus avec des détenus ou des surveillants, le vocabulaire pénitentiaire qui constitue le langage commun de ceux qui y vivent.
Je m’efforce moi-même d’écrire, pour moi-même et dans « transhumances », ce que je vis, semaine après semaine, au contact des détenus. J’envie la capacité de Philippe Claudel à exprimer son expérience de manière aussi claire, simple et émouvante. J’ai choisi de reproduire quatre extraits.
« La prison ressemblait à une usine. Une grande usine qui ne produisait rien, sinon du temps limé, broyé, réduit, des vies étouffées et des mouvements restreints. Les détenus figuraient d’étranges ouvriers, sans machines, sans musettes, mais qui suivaient des horaires, des chemins, des consignes. Les gardiens parfois avaient des allures de contremaîtres. »
« Il y a beaucoup de mensonges en prison, mais ils sont moins graves qu’ailleurs car ils sont essentiels. On ment pour exister un peu plus, et on se ment pour continuer à se supporter. Les crimes bien réels rejoignent les cauchemars, et tout alors prend l’apparence d’une histoire inventée. C’est à ce prix que l’on peut survivre. Pour supporter la prison, il faut devenir un autre. »
« Le nombre de détenus qui m’avouaient qu’ils ne pouvaient rien faire, rien. Ni lire, ni écrire, ni se concentrer sur une émission radiophonique ou télévisuelle. Rien. La prison agissait comme un lavage qui emportait les fonctions intellectuelles même les plus rudimentaires. Ne restaient à l’homme, dans bien des cas, que les réflexes, les mécanismes végétatifs, les élans de survie. »
« Je me souviens de ces deux surveillants accueillant un détenu qui revenait des assises, et qui, sonné par le verdict qui l’avait condamné à dix-huit ans d’emprisonnement, avançait comme un automate. Ils l’entouraient et lui parlaient avec une douceur dont peut-être l’équivalent est à chercher dans celle que l’on trouve chez une mère qui parle à son fils qui pleure. Les deux gardiens murmuraient des choses simples, des mots de réconfort. Ils tutoyaient le détenu et leur tutoiement était alors la plus grande preuve de leur bonté. »